Hallucinations SUR Ultra : Ces Coureurs qui Basculent dans l’Irréel au Péril de Leur Vie
Les sentiers techniques de l'Ultra-Trail ne mettent pas seulement à l'épreuve le corps : ils testent aussi les limites de l'esprit. Parmi les phénomènes les plus troublants que rencontrent les coureurs d’Ultra figurent les hallucinations. Mais comment expliquer ces visions surréalistes qui surgissent au beau milieu de la montagne ? Que nous apprend la science sur ces manifestations du cerveau ?
Dans cet article, nous allons explorer les causes physiologiques et psychologiques de ces hallucinations et découvrir comment les coureurs peuvent s’en prémunir.
Crédit : Sport équipement
la terrible experiance de claude
Un jour, Claude entend parler de la Swiss Peaks, l'une des courses les plus dures au monde : 677 km, 27 000 m de dénivelé, des conditions extrêmes. Il s'inscrit, bien conscient que cela va être un combat physique et mental hors norme.
Mais la course ne se passe pas comme prévu. En raison du confinement, son entrainement est limité. Le stress monte, le manque de sommeil s'accumule, et à la quatrième nuit sans réel repos, la réalité commence à vaciller.
« Je me croyais chez moi, à courir sur mes chemins d'entraînement. Je voyais des amis qui n'étaient pas là. J'ai même vu un coureur partir en rollers ! » hallucine-t-il.
Pire encore, il s'endort en courant et chute. Perdu, incapable de s'orienter, il appelle l'organisation qui le retrouve grâce à son tracker GPS. La décision est prise : il doit abandonner après 220 km.
L’IMPACT DU MANDE de sommeil
Ce récit n'est pas isolé. Selon une enquête menée après l'UTMB en 2015, 56,3 % des coureurs ont déclaré avoir vécu une hallucination pendant la course. Le principal facteur en cause est le manque de sommeil.
Les courses d'ultra-endurance peuvent s'étirer sur plusieurs jours, souvent avec moins de 2 heures de sommeil par nuit. Cette privation altère les fonctions cognitives, notamment la perception et l’attention. Le cerveau en manque de repos compense en créant des images qui n'existent pas : des animaux sur les chemins, des bâtiments imaginaires, voire des compagnons fantômes.
Que se passe-t-il dans le cerveau ?
Lorsque nous manquons de sommeil, le cortex préfrontal, siège de la rationalité, de la prise de décision et du contrôle des impulsions, tourne au ralenti. Cette région joue un rôle essentiel dans l'évaluation des situations et l'analyse logique des informations reçues. Lorsqu'elle est affaiblie, la capacité à distinguer le réel de l'imaginaire se dégrade.
Parallèlement, les régions impliquées dans la perception sensorielle, comme le cortex visuel et auditif, deviennent plus sensibles aux stimuli erronés ou incomplets. Ces aires compensent le manque d'informations en complétant les vides, ce qui conduit à des interprétations déformées et, in fine, à des hallucinations.
De plus, l'effort prolongé déclenche une production accrue de cortisol, l’hormone du stress, qui modifie l'activité du système limbique, une structure cérébrale régulant les émotions, la peur et la mémoire. Cette perturbation altère le traitement des stimuli anxiogènes, intensifie les réactions émotionnelles et accentue l’état de confusion. Cette association stress + fatigue extrême brouille ainsi les circuits habituels de la vigilance et de l’orientation spatiale, amplifiant encore le risque de percevoir des réalités fictives.
L'effet déshydratation et hypoglycémie
D'autres facteurs physiologiques peuvent accentuer ces troubles perceptifs :
La déshydratation : elle perturbe l'équilibre électrolytique et interfère avec la transmission des influx nerveux.
L'hypoglycémie : le manque de sucre prive le cerveau d'énergie, altérant sa capacité à interpréter les informations sensorielles.
Les hallucinations sont-elles dangereuses ?
Dans la majorité des cas, ces visions sont bénignes et disparaissent après une pause et un repos de quelques heures. Cependant, elles peuvent devenir risquées si elles conduisent le coureur à des comportements irrationnels : quitter le sentier, se mettre en danger sur une crête, ou, comme dans le témoignage de Claude, chuter après s'être assoupi en courant.
Bruno, bénévole sur le Grand Raid de la Réunion, raconte avoir retrouvé un coureur hors du sentier, totalement perdu. Ce dernier était convaincu qu'il se trouvait en Bretagne, à plus de 10 000 km de là, et prétendait vouloir rentrer tranquillement chez lui à pied. « Cela peut faire sourire, mais il aurait pu glisser et se retrouver en contrebas dans un ravin. À ce moment-là, il n'avait plus aucun repère, c'était inquiétant », se souvient Bruno. Une situation qui illustre bien les dérives que peuvent provoquer ces troubles perceptifs extrêmes.
Comment prévenir ces phénomènes ?
La gestion du sommeil est un axe central de la préparation aux ultras. Certains coureurs planifient des micro-siestes de 15 à 20 minutes tout les 8 heures d’effort. Une bonne gestion de l'alimentation et de l'hydratation est également cruciale. Enfin, apprendre à reconnaître les premiers signes d’altération cognitive permet d’adapter sa stratégie avant que la situation ne dégénère.
L’esprit, ce compagnon invisible
Les hallucinations rappellent que l'ultra-trail est un défi autant physique que mental. Le cerveau, aussi endurant soit-il, a ses limites. Apprendre à l'écouter est parfois la clé pour franchir la ligne d’arrivée.
Cet article vous a intéressé ? Retrouvez le récit de Claude qui raconte son experiance avec les hallucinations à la Swiss Peaks dans le dernier èpisode de Dans la Tête d’un Coureur.
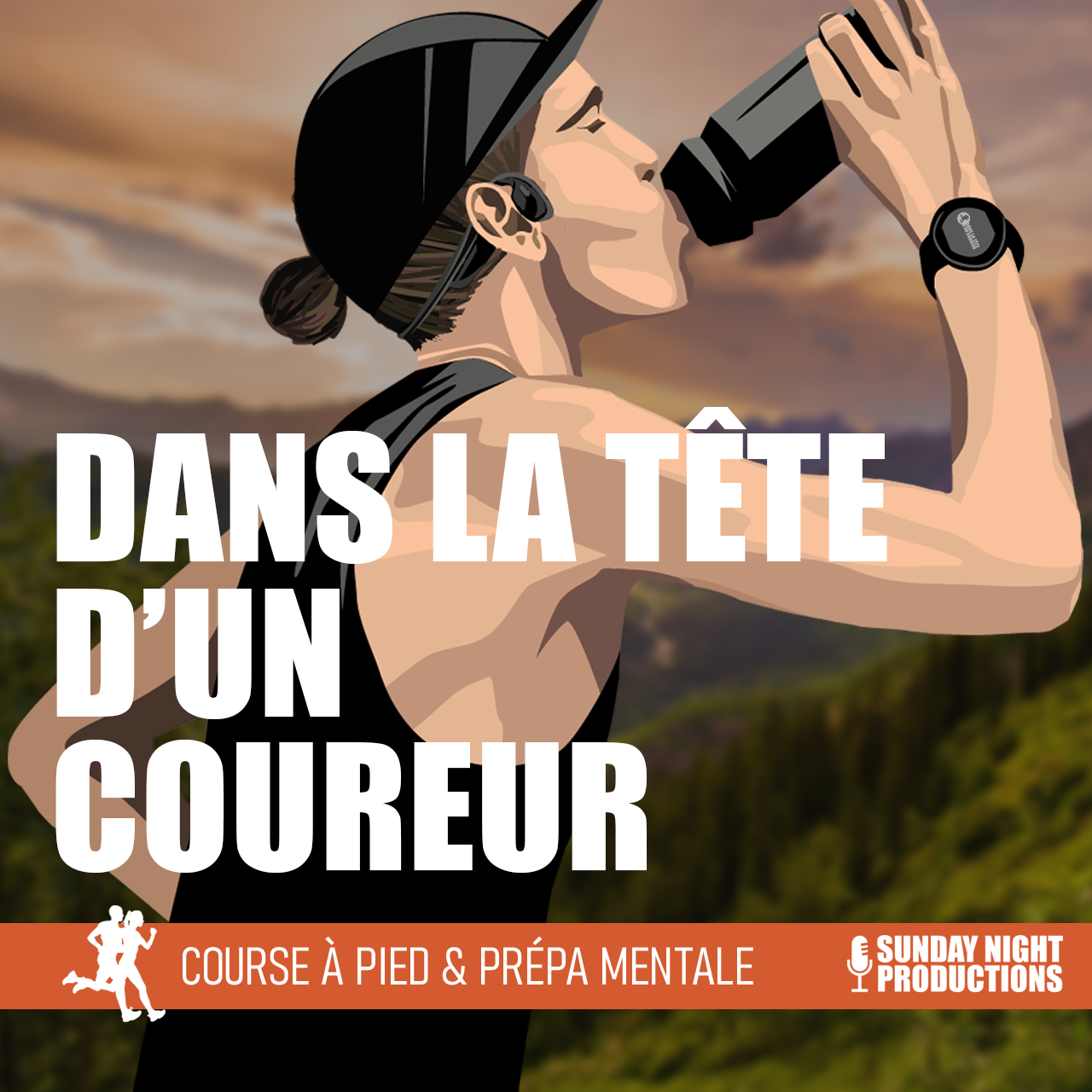




5h03. C’est le temps qu’il lui aura fallu pour boucler les 42,195 km du marathon de New York. Mais pour Amandine Petit, ce n’est pas ce chiffre qui compte. Ce qui compte, c’est qu’elle n’a pas marché une seule fois. Et surtout, qu’elle est allée au bout d’un défi qui lui paraissait, un an plus tôt, littéralement impensable.
De Miss France à marathonienne, il y a tout un monde. Et c’est à New York qu’elle a appris à le traverser.